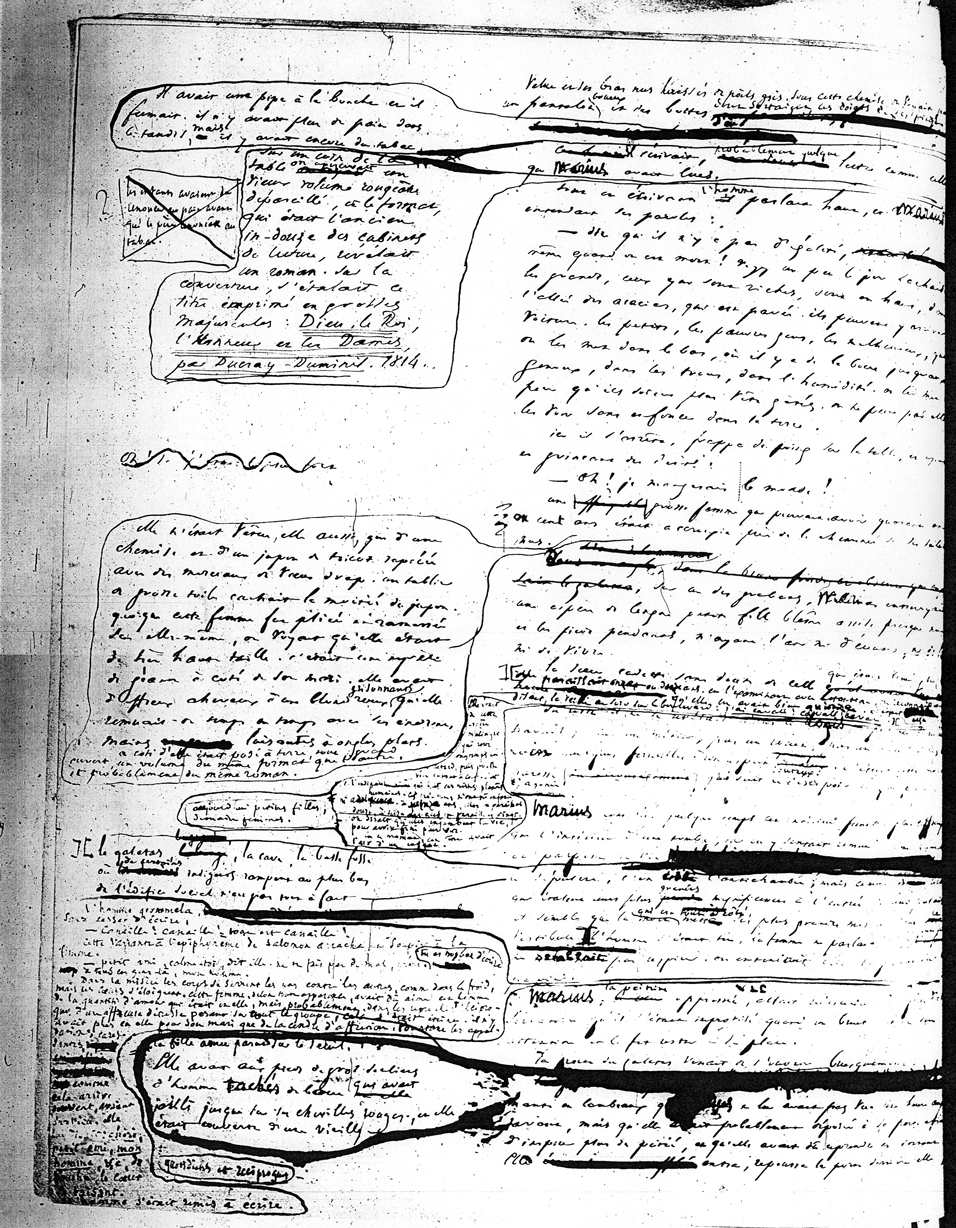NOTICE
pour l'édition des Misérables
I. ÉTABLISSEMENT DU TEXTE
La souris plus le chat, c'est l'épreuve
revue et corrigée de la création.(V, 1, 2)
Cette édition des Misérables est la première qui soit « critique » et jusqu'à présent la seule puisqu'on ne peut pas tenir pour telle celles de la "la Pléiade". Cela peut étonner s’agissant d’un livre d’une telle notoriété. Ses adaptations sont innombrables et sa lettre reste incertaine. Est-ce en raison de la longue présence de l’œuvre dans la littérature vivante dont les livres ne sont pas annotés ni les textes « établis », de son cantonnement presque aussi long dans la littérature populaire, du crédit accordé à la grande collection dite de l’Imprimerie Nationale, du sentiment d’une plus grande urgence pour d’autres tâches ou seulement de l’ampleur et de l’ingratitude de celle-ci, toujours est-il qu’il ne s’est trouvé personne pour s’en charger. Elle n’est d’ailleurs pas si simple qu’on pourrait croire.
Textes de référence
Les sources que l’établissement du texte des Misérables doit prendre en compte sont en effet nombreuses, inhomogènes et trop largement divergentes pour qu'on puisse se satisfaire d'une d'entre elles. Ce sont :
– le manuscrit, presque entièrement autographe, légué par Hugo avec tous les autres à la « Bibliothèque nationale de Paris qui sera un jour la Bibliothèque des Etats-Unis d’Europe », soit deux volumes qui, sous les références BN Nafr 13 379 et 13 380, sont de la part de la Bibliothèque Nationale de France l’objet de soins de conservation si jaloux qu’on s’est contenté de leur photographie sur micro-film dont l'incommodité et les défauts ont été réparés depuis par l'excellente reproduction diffusée par Gallica.
Ce manuscrit contient, en plusieurs endroits, quelques feuillets de la copie initiale, de la main de Juliette Drouet. La copie ayant servi à l'impression ne nous est pas parvenue. On le regrette puisque Hugo, conformément à son habitude, y effectue beaucoup d'additions et de corrections, ainsi que de nombreux choix entre variantes. En règle générale, Hugo les reporte au manuscrit, de sorte que la plupart des écarts entre le manuscrit et l'originale belge se comprennent par là lorsque les épreuves ne les justifient pas. Mais pas tous et la conjecture est inévitable -et hasardeuse- dans la distinction entre une correction de Hugo faite sur la copie et une initiative de la copiste ou des typographes, ou encore, pour l'originale parisienne, d'A. Vacquerie. Quant aux erreurs, elles sont très probablement plus souvent le fait de la copiste que du typographe. Quelques unes ont sans doute échappé à Hugo qui note à la fin d'une feuille des épreuves « Voici une des conséquences de ce que je n’ai pas encore eu le temps de revoir dans toutes ses parties la copie de la 1ère partie. Cette épreuve est encore tellement chargée de fautes (venant de la copie) que je suis à regret forcé d’en demander une 3e. »
– l’originale imprimée à Bruxelles sous le nom de l'éditeur : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1862, 10 vol. in-8 de VI-406, 2ff-444, 402, 366, 358, 346, 490, 466, 448 et 356 pp. ;
– l’originale imprimée à Paris : Pagnerre (impr. J. Claye), 1862, 10 vol. in-8 de 2ff-II-355, 2ff-382, 2ff-358, 2ff-318, 2ff-320, 2ff-297, 2ff-432, 2ff-399, 2ff-400 et 2ff-311 pp.
Dans le cours même de l’impression des ces originales, Hugo demanda quatre modifications au livre Waterloo, qui furent inégalement exécutées. A la fin de l’année 1862, profitant de l’édition au format in-12, plus petit et moins cher, il en demanda quatre nouvelles dans Waterloo, ainsi que deux autres, en III, 8, 20 et V, 9, 4, laissant ignorer à Thénardier le nom de Pontmercy : s’il l’avait su, il n’aurait pas attendu 18 ans pour tenter d’escroquer la famille du général. Ici non plus, il ne fut pas immédiatement obéi (lettre de mars 1863 ; voir IN, t. IV des Misérables, p. 322-323 et B. Leuilliot, ouvr. cité, p. 385 et suiv.). De là la recommandation (lettre de novembre 1864), pour la première édition illustrée (Hetzel et Lacroix, impr. Bonaventure et Ducessois, 1865) d’ «imprimer (je pense que cela va sans dire) d’après la dernière édition (in-18) qui contient des variantes importantes. » Or, on ignore laquelle au juste il faut tenir pour cette « dernière » édition ; il est en revanche certain qu’aucune ne fut revue par Hugo ni même supervisée par Meurice ou Vacquerie. Force est donc, réserve faite de ces intercalations connues, de ne se fier qu’aux vraies originales.
– l’édition de 1881 : Paris, J. Hetzel-A. Quantin, 5 vol. in-8, tomes V à IX de la section « Roman » de la collection des œuvres complètes qui se donne pour leur « édition définitive » et « ne varietur » ;
– l’édition établie par les exécuteurs testamentaires : Paris, Librairie Ollendorf – Albin Michel, 1908-1909, 4 vol. grand in-8, imprimée par l’Imprimerie Nationale et, pour cette raison, dite « IN ». Contrairement à ce qu'on aurait attendu, les quatre volumes des Misérables ne furent pas les premiers de la collection; publiés après la mort de Meurice et Vacquerie, ils étaient pris en charge par leur successeur, Gustave Simon, sans doute assisté de Cécile Daubray.
Or il s'en faut de veaucoup que ces cinq textes soient identiques entre eux et chacun a ses défauts.
Le manuscrit, loin de pouvoir être écarté au prétexte que l’auteur a lui-même veillé à la publication originale, entre en concurrence avec elle, voire mérite d’être privilégié, parce que Hugo a le plus souvent pris soin d’y reporter les corrections ultérieures, faites sur la copie confiée à l’éditeur ou communiquées à lui au moment de l’impression. Il ne se serait pas donné cette peine s’il n’avait pas de quelque manière tenu son manuscrit pour texte de référence. Mais il ne la prend pas toujours, de sorte qu’il faut privilégier son manuscrit mais qu'on ne saurait se contenter de le reproduire.
La publication originale souffre d’une fiabilité affaiblie par sa duplicité. L’originale belge jouit d’une autorité particulière parce qu’elle est la seule dont il soit certain que Hugo ait corrigé les épreuves de sa main – et avec un grand soin. Elle a pour cette raison été choisie, dans la collection Garnier-Flammarion, par R. Journet pour l’édition donnée en 1979 puis par P. Laforgue en 2020.
Ce travail sur les épreuves a été rendue accessible par l'ouvrage de B. Leuilliot, Victor Hugo publie Les Misérables (Klincksieck, 1970). Il donne, outre l’historique très précis de cette publication initiale, toute la correspondance disponible, et à peine lacunaire, de l’auteur avec son éditeur. Elle contient la liste des corrections et ajouts demandés, feuille à feuille, au vu des épreuves successives. Car Hugo refuse le bon à tirer, se fait expédier un second jeu, c’est le plus souvent, voire un troisième, lorsque le nombre et la gravité des fautes lui semblent mériter vérification de l'exécution de ses instructions.
L’originale parisienne, simultanée, devait être composée, sous la supervision de Paul Meurice et Auguste Vacquerie, d’après un pré-tirage belge au fur et à mesure de l’achèvement de la correction des épreuves par Hugo. Sur la fin, pour accélérer les choses, l’éditeur proposa à l’auteur que la correction des épreuves fût confiée à ses amis parisiens ; il s’y refusa et fut apparemment obéi, exception faite des chapitres allant de V, 3, 7 inclusivement à la fin du livre 4, composés sans attendre les corrections d’épreuves de Hugo. Cette lacune mise à part, l’originale parisienne devrait être identique à la belge. Il n’en est rien du fait sans doute des typographes, mais aussi des « fondés de pouvoir » de Hugo, Meurice et surtout Vacquerie, nommément mis en cause par Hugo dans sa correspondance avec Lacroix pour une intervention intempestive, et auquel on peut raisonnablement attribuer un certain nombre d’initiatives malencontreuses : redressements orthographiques ou grammaticaux puristes, rectifications factuelles, transformation systématique des appositions hugoliennes (soldats goujats ; assemblée tribunal ; restaurant cabaret ; jardins vergers ; boîtes tirelires ; robin dameret ; âme atome ; tricornes claques ; sépulcre enfer ; greniers mansardes ; laideur rêve…) en mots composés néologiques. Particuliers aussi à l'originale de Paris quelques reculs prudents: il ne s'agit plus, en II, 7, 3, de «remmancher les goupillons et les sabres», les goupillons seulement; ni de «reconstituer le monachisme et le militarisme», uniquement le monachisme. Le Hugo de Bruxelles s'en prend aux théoriciens qui «appliquent sur le passé un enduit qu’ils appellent ordre social , droit divin, morale, famille, respect des aïeux, autorité antique, tradition sainte, légitimité, religion»; celui de Paris met hors de cause -et de la phrase- l'ordre social, la morale, la famille et même la religion.
Inversement, il est arrivé, exceptionnellement, qu’une ultime correction soit envoyée par Hugo à Bruxelles et Paris trop tard pour que Bruxelles en tienne compte mais à temps pour Paris.
Les deux originales, quoique diversement et inégalement fautives, ont en commun les erreurs répercutées de la copie, particulièrement nombreuses aux premiers livres et Hugo s’en excuse auprès de l’éditeur. Or elles sont souvent lourdes parce qu'elles affectent le texte et malaisées à réparer parce que l'indisponibilité de la copie pour la quasi-totalité de l'oeuvre empêche de les identifier et de les corriger à coup sûr. Outre les ajouts et corrections apportés par Hugo après la publication initiale, c'est la raison qui interdit de s'en tenir à la simple reproduction de l'originale belge et qui oblige à la confronter au manuscrit et aux autres éditions pour distinguer, dans leurs écarts, les corrections faites par Hugo à la copie et les erreurs de la copie ou des typographes. L'édition de Bruxelles par exemple inscrit, en I, 5, 13, un article "soixante-dix" du code d'instruction ciminelle au lieu de "soixante-six" qui est au manuscrit, erreur qui n'est partagée par aucune des autres éditions.
D’autres défauts, moins graves mais beaucoup plus fréquents, tiennent aux initiatives prises par les typographes belges et parisiens en matière de ponctuation et, parfois, de mise en page. Hugo ne les voit sûrement pas toutes ; il en est dont il ne parvient pas à obtenir la correction et beaucoup d'autres qu'il renonce à corriger. La correspondance à propos des Contemplations puis de la Légende des siècles a rendu familière cette manie virgulante des typographes belges, l’irritation de Hugo, sa résignation fréquente, mais calculée (voir J. Dürrenmatt, « Virgules et blancs : une question d’importance ? » dans Victor Hugo et la langue, Bréal, 2005 et Leuilliot, ouvr. cité, p. 79 et suiv.). Mais il s’en prenait aux imprimeurs belges faute d’avoir affaire aux français ; c’eût été pire, car en cela, pour Les Misérables, l’originale de Paris aggrave encore et sensiblement les défauts de celle de Bruxelles.
Ces détails de ponctuation n’affectent qu’exceptionnellement le sens du texte ; mais ils en modifient, assez profondément, l’aspect et le rythme. La fluidité et la vitesse s’en ressentent et, dans les dialogues, l’imitation du flux de la parole. Une certaine lourdeur correctement grammaticale multiplie les entraves dans la phrase de Hugo ; sa souplesse, sa vivacité, sont en partie perdues. La règle veut, par exemple, qu'il n'y ait pas de virgule entre le dernier terme d'une énumération et le verbe; s'ils en trouvent une, les typographes l'effacent, Hugo demande souvent son rétablissement – et ne l'obtient pas toujours. Il est pourtant possible de lire mais impossible de prononcer « La sueur, la chaleur, le voyage à pied, la poussière ajoutaient je ne sais quoi de sordide à cet ensemble délabré. » sans qu'on entende « la poussière ajoutait ».
Et, plus cela va, plus la volonté des typographes se substitue à celle de Hugo. Car on assiste, d’édition en édition, à une progressive majoration de la ponctuation : point au lieu de point-virgule ; capitale après un point d’exclamation ; point-virgule au lieu de virgule et virgule là où il n’y en avait pas. Dans le seul et bref chapitre III, 8, 7 par exemple, l’originale de Paris majore la ponctuation deux fois par rapport au manuscrit et à l’originale belge, l’édition de 1881 9 fois et l’IN 10. Observons enfin que si B. Leuilliot note avec raison l’adaptation progressive des typographes belges, à la ponctuation de Hugo, l’inverse n’est pas moins vrai. Mais ces concessions réciproques n'affectent que l'originale de Bruxelles.
A voir avec quels scrupules mesquins l’originale de Paris (et à sa suite l’édition de 1881, qui en rajoute encore) corrige Hugo – mais aussi avec quelle tranquille infidélité, lorsqu’il s’agit, par exemple, d’ôter leur majuscule à la Révolution et à la République –, on comprend mieux pourquoi Hugo nota un jour qu’il fallait considérer comme édition de référence, pour toutes les œuvres de l’exil, l’originale belge, moins cultivée mais plus consciencieuse, et somme toute plus intelligente.
L’édition de 1881, confiée par Hugo aux soins de ses futurs exécuteurs testamentaires, les mêmes Paul Meurice et Auguste Vacquerie qui avaient veillé sur l'originale parisienne, est la dernière publiée du vivant de l’auteur. Les règles classiques de la « philologie » la feraient prendre pour référence si elle avait été corrigée par l’auteur ou, du moins, établie sous son contrôle. Or, si elle a bénéficié de directives générales – le remplacement, par exemple, des noms tronqués jusque-là par le nom complet (Digne et non plus « D.– ») – et des intercalations demandées pour les éditions immédiatement postérieures à l’originale, rien ne prouve que Hugo ait personnellement veillé au détail ou seulement pris connaissance des épreuves, ne fût-ce que par sondage. Aucune preuve matérielle et directe ne prouve non plus le contraire. Qui reste cependant très probable. D'abord parce que Meurice et Vacquerie son présents au contrat et largement rétribués pour leurs soins. Surtout parce que l’édition de 1881 contredit trop souvent la volonté antérieure connue de Hugo – et toujours dans le sens d’un affaiblissement – pour qu’on puisse imaginer qu’il en ait été responsable. D’une part, en effet, elle ne se reporte pas aux épreuves corrigées en 1862 et, se fondant apparemment sur une copie, mais non sur le manuscrit, elle revient plusieurs fois sur des corrections demandées et exécutées dans les originales, auxquelles elle devient par là très inférieure. D’autre part, et contrairement à la volonté connue de Hugo recommandant de reproduire l’originale belge de ses œuvres de l’exil, c’est celle de Paris, ou l’un de celles produites sur son modèle, qui est suivie – la preuve matérielle s’en trouve à ce chapitre V, 3, 7 déjà mentionné (et, de manière moins certaine, jusqu’à la fin du livre 4, soit les feuilles 23 à 28 du tome IX) pour lequel elle ignore, comme l’édition parisienne, toutes les corrections effectuées aux épreuves. Si elle abandonne quelques interventions particulièrement intempestives (en particulier le trait d’union affecté aux appositions), elle accepte en général les erreurs de son modèle. Son principal défaut est d’entériner la ponctuation de l’originale de Paris et de l’alourdir encore en la normalisant de manière systématique. Le sens n’en est que rarement modifié, mais l’accent et le rythme le sont beaucoup et partout. Bref, c’est la plus mauvaise des éditions de référence et nous regrettons ici publiquement de l’avoir fait adopter pour l’édition « Bouquins » des œuvres complètes. C’est le péché mignon des « littéraires » que de se prononcer sans savoir.
Dans ces conditions, la ne varietur ne pourrait recevoir quelque autorité que de l’hypothèse qu'elle aurait reproduit une édition postérieure aux originales et revue par l'auteur. Cette hypothèse, que ne fonde aucun élément positif, expliquerait que l’IN – dont les rédacteurs étaient assez proches des exécuteurs testamentaires pour être informés par eux de l’histoire du texte – suive souvent 1881. Mais s’il en était ainsi, l’IN ne s’en écarterait jamais sinon pour corriger les coquilles et s’abstiendrait de revenir au manuscrit comme elle le fait souvent. Il faut donc faire l’économie de cette vaine supposition et penser que les éditeurs de 1881 ont travaillé avec le même matériel que nous, mais avec des scrupules amoindris par leur proximité du « maître » et en laissant de côté ses corrections d’épreuves.
L’ «IN » ne mérite aucunement, pour ce livre du moins, les critiques qu’on lui a faites sans examen – et nous sommes du nombre. Il est certain qu’elle est établie au vu du manuscrit, dont les leçons altérées par les éditions et d'abord par la copie sont souvent rétablies très attentivement. Et judicieusement car, quoiqu’elle ne se réfère pas aux corrections d’épreuves, plusieurs fois non suivies [ex. en IV, 14, 6] , l’IN évite généralement de revenir au manuscrit lorsqu’elle suspecte une correction ultérieure faite par Hugo. Ce faisant elle se trompe parfois, mais rarement. En revanche, elle intègre plusieurs corrections postérieures à la copie et peut-être à la publication initiale, certaines portées sur le manuscrit et d’autres non. Et elle écarte la plupart des interventions indiscrètes pratiquées dans l’originale de Paris et répercutées par l’édition de 1881. Pas toutes cependant et c’est, avec le recours non normé au manuscrit, sa principale faiblesse. Bref, quant aux mots, l’IN peut être considérée comme sûre, mais ni plus ni moins que l'originale belge. En revanche, tout se passe comme si elle adoptait la ponctuation de l’édition de 1881, sauf les cas, trop rares, où elle la juge indéfendable et retourne à celle du manuscrit, et en agravait encore les défauts. Somme toute et réserve faite de sa ponctuation d'école primaire, l’IN est une excellente édition, qui souffre cependant de ne jamais expliciter ses choix et de n’obéir à aucune règle, même implicite.
L’établissement des Misérables se trouve donc confronté à cette difficulté qu’il est impossible de prendre aucun texte pour référence, c’est à dire de le reproduire en n'y corrigeant que les coquilles. Le manuscrit, parce que les modifications du texte effectuées sur la copie ou à la correction des épreuves n’y sont pas toutes reportées (celles concernant la ponctuation ne le sont jamais) et parce qu’il est souvent démenti, en matière de ponctuation et d’alinéa en particulier, à la correction des épreuves, soit de l’initiative de Hugo lui-même, soit par son acceptation de celle des typographes. Les éditions, parce qu’aucune n’est exempte de fautes, soit de leur propre fait soit provenant de la copie communiquée à Bruxelles. Sans doute Hugo a-t-il vérifié cette copie et corrigé de sa main les épreuves de l’originale belge mais, outre qu’il a lui-même indiqué ou demandé des modifications postérieures à sa publication et qu’aussi soigneuse fût-elle sa correction des épreuves n’a pas été infaillible, il a largement consenti, en matière de ponctuation surtout, à des usages qui n’étaient pas les siens et dont il se plaignait. « Méfiez-vous des : j’en use fort peu », « Ne jamais mettre de points suspensifs à où je n’en mets pas. » etc. (voir B. Leuilliot, ouvr. cité, p. 82).
Avait-il la faculté de faire imprimer un texte entièrement conforme à ses voeux ? Sans doute, dans l’absolu. Mais à voir ce qu’il en est concrètement, les milliers d’écarts entre le manuscrit et l’originale belge – la plus docile – on comprend qu’il n’en avait pas le pouvoir en réalité et qu’il lui fallut composer et en rabattre, pour Les Misérables comme pour Les Contemplations. Visiblement, à la correction des épreuves, Hugo laisse passer les ponctuations abusives vénielles et réserve son autorité pour les redressements essentiels, ceux qui affectent la syntaxe, le sens ou le rythme. D’ailleurs, la copie envoyée à Bruxelles était loin d'être parfaite (une page entière oubliée en III, 8, 4, deux en IV, 3, 4!). Enfin, quoique Hugo soit étonnamment vigilant, attentif et précis, le manuscrit lui-même n’est pas exempt de fautes, rares mais indiscutables.
Devant l’impossibilité de reproduire purement et simplement aucun des textes « princeps », il faut les employer tous, les comparer et, lorsqu'ils ne sont pas identique, trancher non par péférence personnelle arbitraire mais selon des règles déduites des qualités propres de ces textes et permettant de les corriger les un par les autres selon le niveau de leur fiabilité. Ce qui précède conduit à adopter les suivantes, qui font droit, classiquement, au principe de reproduire la meilleure édition publiée du vivant de l'auteur mais l'appliquent ponctuellement à chaque occurence problématique.
Règles
On reproduit, en cas de désaccord, la version donnée par deux des trois textes pour lesquels l’intervention de Hugo est certaine ou possible : le manuscrit, l’édition originale (celle de Paris ou celle de Bruxelles et lorsqu’elles divergent, c’est celle qui reproduit le manuscrit qui est prise en compte) et l’édition de 1881. La référence à l’IN sert de contrôle pour la lecture du manuscrit. Etant entendu qu'on assimile ici au manuscrit les instructions de la main de Hugo postérieures à la publication des originales: les dix intercalations ultérieures à l'originale belge et la directive, en tête du manuscrit, par laquelle Hugo demande qu'après sa mort - l'édition de 1881 y pourvoit sans attendre -, certains noms propres d'abord réduits à leur initiale soient imprimés complets.
Cette règle avalise donc, et c'est le plus souvent, l'accord entre le manuscrit et l'édition de Bruxelles, qui en est la plus proche, et elle rejette les initiatives, plus nombreuses qu'on n'imagine, de l'originale parisienne et de 1881, mais elle fait droit au rare consensus entre le manuscrit et l'édition de Paris ou de 1881 pour censurer un errement de l'originale belge. Elle intégre au texte établi les corrections et ajouts apportés aux Misérables trop tard pour que l'originale belge et, pour certaines, l'originale parisienne, aient pu en tenir compte, mais qui ont été faites dans les éditions ultérieures. En revanche, elle avalise l'édition aux dépens du manuscrit lorsque l'originale belge et 1881diffèrent ensemble du manuscrit. Le plus souvent – et c'est fréquent – l'écart laisse présumer une modification apportée à la copie; parfois il faut, même si l'IN ne s'y résout pas, constater et enregistrer l'abandon d'une correction ou d'un ajout ponctuel porté sur le manuscrit mais que Hugo ne s'est jamais préoccupé de communiquer aux éditeurs.
Cette norme générale s'assortit des quatre précisions suivantes:
Les corrections demandées sur épreuves priment toute autre considération. Elles ont en général été exécutées par les typographes auxquels elles étaient adressées; mais il arrive qu’elles ne le soient pas, surtout dans l’édition de Paris. Il arrive aussi qu’elles l’aient été aux deux originales, mais que l’édition de 1881 s’en écarte pour recommencer une faute pourtant corrigée. Il arrive enfin que l’IN préfère le manuscrit aux éditions sans prendre garde qu’elle dément une correction demandée aux épreuves. Ainsi avons nous rendu au chapitre V, 3, 7 son titre « L’extrémité » dont la substitution, lors des corrections d’épreuves, à « Quelquefois on échoue où l’on croit débarquer » avait été ignorée par l’originale de Paris puis par toutes les autres éditions ultérieures, IN comprise.
Lorsque – c’est très rare – les trois sources sont différentes on choisit entre elles, non sans s’en expliquer, avec une préférence de principe pour le manuscrit.
On le fait aussi lorsque les deux éditions de référence sont en désaccord et que le manuscrit est douteux, ce qui n'arrive que pour la ponctuation.
On ne reproduit enfin le manuscrit de préférence aux éditions que lorsque l’erreur de ces dernières est explicable par une réalité perceptible du (ou des) manuscrits ou par un mécanisme mental très probable : correction par le typographe des fautes d'orthographe de Thénaardier (III, 8, 3); erreur de lecture de la copie récurrente (la confusion entre « c » et « l ») ou qu’explique l’aspect du manuscrit (par exemple lorsqu'un accent à la ligne inférieure a été pris pour la virgule d'un point-virgule ou lorsqu’une suppression a placé le début d’une phrase en alignement avec les débuts de paragraphe et que la copie a fait un alinéa sans prendre garde que cette position n’était due qu’à la rature – et inversement). Cette condition ajoutée au principe de la lectio difficilior tient au privilège reconnu à la publication: elle n'exécute pas l'écriture, elle l'achève.
Toute règle implique exception; celles que nous faisons sont explicites et argumentées.
Majuscules et orthographe
Quelques remarques avant d’en venir aux questions de procédure et de présentation.
Dans son manuscrit, Hugo use des majuscules avec une parcimonie qui surprend, même quand on ne partage pas le préjugé de sa grandiloquence. Il les oublie très souvent aux noms propres et n’en met pratiquement jamais en début de phrase. Mais il dessine assez nettement les points, virgules et point-virgule pour que cette habitude ne soit embarrassante qu’après les points d’interrogation et d’exclamation – dans les dialogues ou monologues intérieurs en particulier. Où faut-il indiquer, par une majuscule, le début d’une nouvelle phrase ? et où l’intonation doit-elle donner dans un même souffle l’interrogative ou l’exclamative et l’assertive qui la suit ? Là, ce sont les typographes qui ont tranché, à la suite peut-être de la copie, si du moins elle était différente de celle dont des éléments ont été conservés dans le manuscrit, ce qui est peu probable. Ceux de l’originale belge, suivis le plus souvent par ceux des éditions ultérieures, l’ont fait en règle générale à la satisfaction de Hugo puisqu’il n’y a pratiquement aucune correction de ce type aux épreuves. Quoi qu’on en pense soi-même parfois, on les suit donc également, en appliquant aux divergences la règle commune. En revanche, la rareté même de la majuscule au manuscrit oblige à le suivre lorsqu’il l’emploie et à faire alors, plus d’une fois, infraction à notre règle. Hugo écrit Révolution et République lorsqu’il s’agit de l’idée ou du principe et république ou révolution pour les événements et les régimes ; les éditeurs tendent à faire l’inverse ; on peut d’autant moins s’y plier que leur conduite est inhomogène et irrégulière. Il veille aussi, dans les dialogues, à écrire en toutes lettres « monsieur » et non pas « M. »; on a respecté ce soin, quelle qu’ait été la pratique, d’ailleurs instable, des éditions.
En revanche, nous n’avons indiqué que par curiosité ou amusement les écarts sans valeur de signification ou de rythme –les originales seules respectent l’Etat et les Evangiles– et, d’une manière générale, n’avons accordé d’intérêt que par intermittence aux faits d’orthographe. Certains sont d’époque –piége, cortége, poëte et poëme, le trait d’union, d’ailleurs charmant, entre « très » et l’adjectif qu’il modalise– et disparaissent, pas toujours d’ailleurs, au-delà des originales ; d’autres relèvent de l’idiolecte hugolien, argumenté comme on sait : aîle, cîme, quatrevingt-treize ; d’autres enfin –redingotte, gargotte, guet-à-pens ou guet à pens– semblent bien de simples fautes, dont Hugo accepte sans discussion la correction par les typographes, quand il ne l’effectue pas lui-même sur la copie. Tous sont signalés, mais pas à chaque occurrence, pas plus que les négligences récurrentes au manuscrit : l’absence régulière des traits d’union dans « c’est-à-dire » par exemple, ou les accents manquants (peu nombreux à chaque page mais, au total, il y en a beaucoup). Quant à l’orthographe du texte finalement donné, l’application de nos règles excluait, par définition, toute uniformisation. Hugo n’en pratique aucune –et l’on trouve « Grand Egout », « Grand égout » et « grand égout » ; les éditions le tentent à partir de l’originale de Paris et finissent toujours par s’embrouiller ou par commettre de vraies (petites) fautes parce que la normalisation contredit un emploi particulier au texte (ainsi de « M. » pour « Monsieur »).
Apparat critique
Les « données d’établissement » du texte apparaissent en « consultation » et peuvent être appelées, livre par livre, depuis la table des matières ou depuis le texte déjà convoqué sous une autre forme. Elles figurent au fil du texte entre crochets droits, en bleu pour la ponctuation, l'othographe et la mise en page, en rouge pour le texte proprement dit lorsque son établissement est problématique, et se lisent en clair, sans autre abréviation que « ms » pour manuscrit et « 1881 » pour l’édition ne varietur. Elles portent toujours sur ce qui précède et signalent les écarts que présente le manuscrit ou telle édition avec le texte tel qu’il est établi. Ainsi « Thénardier [originale de Paris, 1881 et IN : virgule] » signifie que ces trois éditions ont placé une virgule après « Thénardier » et que ni le manuscrit ni l’originale belge n’en comportent, ni donc non plus notre texte conformément aux règles susdites. La source du texte adopté se trouve ainsi identifiée par défaut. Enfin, les instructions données lors de la correction des épreuves, reprises de l’ouvrage de B. Leuilliot, sont transcrites : « L » suivi du numéro de la page. On y a distingué entre correction « redemandée », qui rétablit le texte du manuscrit (et sans doute de la copie), et correction « demandée », qui modifie le texte du manuscrit (et de la copie).
La comparaison avec le manuscrit est exhaustive : tous les écarts entre le manuscrit et le texte produit sont signalés ; si bien que notre édition avec ses « données d’établissement » comporte implicitement une transcription complète du texte donné par le manuscrit (incertitudes de lecture comprises).
Avec l’exception suivante. Dans les dialogues, Hugo place presque toujours le point d’interrogation ou le point d’exclamation non pas à la fin de la phrase interrogative ou exclamative mais après le « dit-il », « s’écria-t-il », « demanda-t-il » qui supporte le dialogue. Cet usage désuet, et qu’il l’abandonne progressivement, n’est pas suivi par l’originale qui ponctue comme nous le faisons, ni par les éditions suivantes; Hugo ne le rétablit jamais aux épreuves. Il nous a semblé inutile d'en faire état autrement qu'ici, une fois pour toutes.
Exhaustive est aussi la comparaison avec les deux originales, parisienne et bruxelloise.
En revanche, les écarts entre le texte adopté et les éditions de 1881 et de l’IN ne sont pas tous signalés. La comparaison, en effet, a été conduite en vue de l’application de nos règles et à partir de la confrontation du manuscrit avec les originales. Lorsque ces trois textes concordaient et suffisaient à l’établissement, il était inutile de se reporter aux suivants de sorte que l’IN et 1881 présentent certainement plus d’écarts avec eux et avec notre texte qu’il n’en est noté.
On ne donne du manuscrit dans ces « données d’établissement » que ses écarts avec les éditions et/ou avec notre texte. Inutile d’y chercher les mots raturés et les versions abandonnées – cela figure en « Texte des Misères » ou en « Version initiale ». Cependant, lorsque le manuscrit donne deux versions entre lesquelles Hugo n’a pas encore choisi (il le fera sur la copie), on les indique toutes deux, en permettant de savoir laquelle est la « variante sans choix » de l’autre. Dans quelques cas, rares et remarquables, une version abandonnée est signalée pour l’intérêt de la chose, par exemple lorsque « épique » est substitué à « lyrique » pour qualifier l’ « effusion » de Marius dans sa grande apostrophe du Café Musain à la gloire de l’empereur.
Exemple
Soit, pour illustrer la présentation de l’apparat critique et la typologie des cas de figure les plus courants, ces extraits du chapitre III, 8, 4 Une rose dans la misère :
Correction demandée aux épreuves, infirmant le manuscrit et la copie et exécutée par toutes les éditions :
« Une toute jeune fille [suppression d’une virgule indue, reste d’une correction au ms, demandée aux épreuves (L248)] était debout »
Correction demandée aux épreuves pour revenir au manuscrit (et à la copie si elle n’était pas fautive) et exécutée par toutes les éditions :
« C’était une créature hâve, chétive, décharnée; [point-virgule redemandé aux épreuves (L249)] rien qu’une chemise et une jupe »
Unanimité des éditions contre le manuscrit,
plus ou moins regrettable mais presque négligeable :
« Dans sa première enfance, [pas de virgule au ms] elle avait dû même être jolie. »
salvatrice :
« Il y [le « y » manque au ms] a quelquefois du gros monde; il y a aussi du monde qui sent mauvais. »
Faute de l’originale de Paris s’écartant de toutes les autres éditions et du manuscrit :
« il avait heurté sur le boulevard sans les reconnaître les filles Jondrette, car c'était [originale de Paris : « étaient »] évidemment elles, »
« Par instants sa chemise [virgule à l’originale de Paris] défaite et déchirée [virgule à l’originale de Paris] lui tombait presque à la ceinture.»
Ecart injustifié, par rapport au manuscrit et à l’originale belge, de l’originale de Paris suivie par 1881 mais non par l’IN :
« Quand je pensais à me noyer, je disais: Non, [originale de Paris et 1881 : point-virgule] c'est trop froid. »
Ecart de l’originale de Paris, suivie par les deux éditions ultérieures, avec le manuscrit et l’originale belge :
« Par instants [originale de Paris, 1881 et IN : virgule] sa chemise défaite et déchirée lui tombait presque à la ceinture. »
Faute des originales (ce sont 1881 et IN qui sont conformes au manuscrit et la faute a échappé à Hugo lors de la correction des épreuves)
minime :
« Elle s'approcha de lui, et lui posa une main sur l'épaule. [originales : deux point et pas de passage à la ligne]
–Vous ne faites pas attention à moi, mais je vous connais, monsieur Marius. »
carrément grave (et provenant sûrement de la copie) :
« Et comme si ce [originales : « le »] soleil eût eu la propriété de faire fondre dans son cerveau des avalanches d'argot »
Ecart injustifié de l’édition de 1881 et de l’IN avec le manuscrit et les originales :
« –Dieu de Dieu! avons-nous cherché, ma soeur et moi! Et c'est vous qui l'aviez trouvé! sur [1881 et IN : majuscule] le boulevard, n'est-ce pas? »
Majoration indue de la ponctuation par l’IN seule :
« elle aperçut sur la commode une croûte de pain desséchée qui y moisissait dans la poussière, [IN : point-virgule] elle se jeta dessus »
Faute majeure de 1881 et de l’IN à sa suite :
« – Il prit les seize sous et donna les cinq francs à la jeune [« jeune » manque en 1881 et dans l’IN] fille. »
Exception faite aux règles d’établissement du texte :
« Ma fille aînée vous dira que nous sommes sens [originales et 1881 : « sans »; on rétablit l'orthographe donnée à Thénardier par le manuscrit] un morceau de pain depuit [originale de Paris et 1881 : « depuis », idem] deux jours, » Les deux originales (et donc peut-être la copie) ainsi que l’édition de 1881 dans le premier cas, et, dans le second, l’originale de Paris (mais pas celle de Bruxelles et donc pas la copie) et l’édition de 1881 ont corrigé la faute d’orthographe que le manuscrit donnait à la lettre écrite par Thénardier ; cela s’était déjà produit dans le chapitre précédent.
Précisions et doutes
A mesure que la lecture des épreuves avance, mais avec un saut perceptible à hauteur de la quatrième partie, Hugo simplifie la transcription de ses corrections et, au lieu d’indiquer, comme jusque là, « après tel mot, virgule », se contente de recopier le mot et la ponctuation qu’il souhaite. Du moins est-ce très probable car, en l’absence de toute autre information, on ne peut exclure que la correction ait porté sur le mot lui-même. De là un problème : l’annotateur doit-il interpréter l’instruction donnée ou s’en tenir à sa lettre ? Nous avons préféré le second parti. Non sans hésitation car le premier est pertinent jusqu’à la troisième partie, mais c’est le second qui le serait à partir de là. Il faut donc entendre l’indication « correction sur ce mot (ou ces n mots) » comme valant, presque toujours, pour la ponctuation qui les suit - ou les sépare- jusqu’à l’emplacement de cette annotation. Pratiquement, on peut considérer que lorsque aucune ponctuation n’est incluse dans la portée de la correction, elle vaut pour la typographie ou l’orthographe du ou des mots concernés et que dans le cas contraire, c’est la ponctuation qui est visée.
Or une évolution analogue caractérise le manuscrit lui-même jusqu’à la cinquième partie exclusivement, rédigée pendant l’exil et très soigneusement écrite. De bout en bout, sa lisibilité est inhomogène tant pour la netteté et le soin de la graphie que du fait du nombre des corrections apportées, mais, d’une manière générale, elle s’affaiblit sensiblement à la quatrième partie. Faute de temps sans doute – la rédaction s’accélère et le manuscrit prend l’aspect d’un manuscrit de travail et non d’une mise au net – mais aussi du fait que Hugo rencontre là, dès avant l’exil et plus encore après, des problèmes d’ajustement idéologique et littéraire plus sérieux que jusqu’alors.
La combinaison de ces deux évolutions – une correction d’épreuves plus rapide et un manuscrit moins net (pour les copistes d’abord) – aboutit à accroître sensiblement le nombre des cas d’insatisfaction devant les règles d’édition que nous nous sommes données. La proportion des circonstances où leur application aboutit au meilleur texte possible, très favorable dans les trois premières partie et la dernière, baisse pour la quatrième et leur coût rapporté à leur bénéfice semble plus lourd.
Le texte ainsi établi est-il le meilleur ? De ceux qui sont possibles ? ce n’est pas certain. Car on peut en imaginer un autre, de qualité au moins égale et que nos « données d’établissement » suffisent à construire. Indifférent, ou presque, à la tradition éditoriale, il résulterait : du manuscrit, des corrections apportées aux épreuves, des instruction ultérieures de la main de l’auteur (les noms complets et non réduits aux seules initiales et quelques modifications connues (voir IN, t. IV des Misérables, p. 322-323 et B. Leuilliot, ouvr. cité, p. 385 et suiv.)) et des corrections ou ajouts portés sur la copie, quand on en dispose ou que l’originale belge leur donne une probabilité suffisante. Signalons aux courages intéressés qu’il ne faudrait pourtant pas revenir à la ponctuation déviante du manuscrit pour les interrogatives et les exclamatives des dialogues puisque Hugo y renonce progressivement dès le manuscrit et accepte celle de l’originale belge.
Le meilleur de ceux qui existent ? Sans doute, du moins l’espère-t-on. Sans en être bien certain non plus. Car il est de règle, c’est l’entropie de l’imprimé, que les rééditions successives ajoutent leurs propres fautes à celles du texte qu’elles prétendent reproduire. L’édition électronique reproduisant l’IN qui nous a dispensé de dactylographier cet énorme texte (http://www.livresse.com/Livres-enligne/lesmiserables) et qui avait l’incomparable mérite d’être la seule en ligne, ne faisait pas exception. On s’est efforcé d’y remédier et de ne pas y ajouter trop de fautes de notre cru; l’une des supériorités de la publication en ligne étant d’autoriser à peu et frais et immédiatement la correction, on remercie les lecteurs qui nous permettront de mettre leur vigilance au service des Misérables.
II. ÉDITION GÉNÉTIQUE
Une fois récusés les deux modèles anciens –le classique, où l’artisan remettant son ouvrage sur le métier balaie et brûle les copeaux, et le romantique, où l’on ne déshabille pas la Muse pour savoir comment elle est faite– la question de la formation des œuvres d’art se pose. Effectivement, on ne s’est préoccupé des manuscrits littéraires –sinon pour établir les textes–, des « sources » et des « variantes » qu’à partir du dernier quart du 19° siècle. Mais, en l’absence d’une représentation de l’art cohérente et généralement acceptée, ce ne fut et ne reste guère plus que du bricolage. Les mots le disent : « genèse » relève d’une représentation religieuse d’un acte créateur aux voies impénétrables, mais « génétique » implique un auto-développement selon des processus déterminés et intelligibles. La pénétration dans les « arcanes de la génération des poèmes » oscille entre adoration d’un mystère et décryptage de génomes.
De là peut-être, dans les travaux de « génétique littéraire » proprement dits et dans ceux beaucoup plus nombreux, les éditions avec « choix de variantes » par exemple, qui y participent sans en revendiquer le nom, une révérence affichée envers le savoir et une ignorance complète de ses conditions les plus élémentaires qui veulent qu’on définisse, ou qu’on laisse au moins deviner de quelque manière, dans quelle perspective on se place et la nature de la connaissance qu’on prétend exposer. Les valeurs attachées naguère à la prouesse solitaire, avec son parfum de sainteté bénédictine, et maintenant à la performance technique, avec la puissance institutionnelle des « laboratoires » et « instituts », compensent tant bien que mal l’exiguïté de la portée de ces travaux, pour ne pas dire leur vanité.
Doctrine
Bricoleur donc, résolument et d’abord pour mon plaisir, voici pourtant la conviction qui sous-tend la présente « édition génétique ». Les œuvres littéraires ne sont pas des objets mais des histoires. Elles n’existent, sinon comme encombrement des bibliothèques, que dans la relation avec leur lecteur et leur auteur –qui est aussi leur premier lecteur. Relation essentiellement fluctuante, dépendant de l’expérience, du savoir, de la culture. Lit-on Les Misérables avec l’insurmontable répulsion d’alors devant un bagnard, même libéré, la même qu’aujourd’hui face à un terroriste, pédophile de préférence ? Ou encore ceci. Hugo sait qu’il date le mariage de Cosette avec Marius de sa première « nuit » avec Juliette, celle du 16 au 17 février 1833 ; Juliette le sait aussi qui l’en remercie avec effusion lorsqu’elle le découvre en faisant la copie du manuscrit ; les autres lecteurs l’ignorèrent jusqu’à la fin du premier tiers du XX° siècle, la famille et les proches ayant eu soin de dissimuler l’existence même de Juliette ; ils le savent maintenant ou peuvent l’apprendre à la lecture des notes. Le sens de l’œuvre en est-il changé ? Légèrement tout de même : outre l’ajout de tous les vertiges devant l’autobiographique, cela compense la mutation du sens induite par la forte dépréciation de cette idylle sous l’effet de l’évolution des mœurs. Laquelle résiste : insignifiant coup de chapeau que cette date, accordé en secret et d’ailleurs bien ambigu. Mais on apprendra dans cette édition-ci qu’en rédaction tout à fait initiale ce n’est pas le mariage de Marius et Cosette mais leur rencontre qui est datée de l’année, 1833, où Hugo fit celle de Juliette et qu’il mélange d’emblée les souvenirs de l’épouse (le coup de foudre et les regards au Luxembourg) avec ceux de l’amante. C’est amusant aujourd’hui, c’était parfaitement scandaleux ; on lit maintenant Les Misérables avec l’idée du bagne comme d’une chose révolue –et cela valide sa perspective progressiste mais affaiblit son effort militant. On les lit aussi avec en tête l’une ou l’autre de ses innombrables adaptations ; Jean Valjean a le visage de Gabin ou celui de Liam Neeson et l’on ne peut s’empêcher de chanter mentalement Je suis né à Nanterre sur la musique de Schönberg. Quand on les lit du moins. Car toutes les statistiques montrent que ses adaptations ont relayé l’œuvre comme depuis longtemps l’Histoire sainte, écrite ou filmée, pour la Bible. Bref Les Misérables ne sont plus ce qu’ils étaient, peut-être même ne sont-ils plus tout à fait un livre.
Ils ne l’ont d’ailleurs pas toujours été ; des premiers jours de leur existence jusqu’à 1848, cela s’appelait Les Misères et c’était un manuscrit. Bien différent des Misérables et de plus en plus éloigné d’eux à mesure qu’on remonte dans le temps. On pourra ici s’en convaincre. Javert, par exemple, n’avait rien d’un « saint Michel monstrueux » ; brave homme seulement atteint de déformation professionnelle, il est plein de remords pour ses (in)justes soupçons et ravi de pouvoir partager l’admiration religieuse de Montreuil-sur-Mer pour son maire une fois Jean Tréjean (la plupart des personnages changent de nom) reconnu en Champmathieu.
Somme toute le « texte » n’existe réellement qu’en deux lieux : dans la pratique éditoriale, d’ailleurs récente et résultant de l’imprimé, qui le reproduit à l’identique et dans l’abstraction nécessaire que toutes les études formalistes, de la rhétorique à la « poétique », font de ses transformations. Pratique et abstraction validées contre toute raison par les généticiens lorsqu’il parlent d’ « invariant textuel ». Cette fiction leur est utile pour arrêter leur travail à la première édition publiée –comme si, presque toujours, les écrivains ne le poursuivaient pas à travers les éditions successives !–, et pour respecter ainsi la division du travail scientifique qui réserve à d’autres spécialistes l’établissement du texte et à d’autres encore ce que l’ancienne histoire littéraire appelait la « fortune » de l’œuvre. Elle leur est utile aussi pour éviter l’aporie du raisonnement par la queue du cheval : quand l’adaptation devient-elle usurpatrice ou traître ? à quel moment de leur histoire Les Misérables cessent-ils d’être Les Misérables ? Elle leur est surtout utile pour éviter la même aporie en amont et prononcer l’identité du texte depuis le tout premier scénario jusqu’à la publication. Mais c’est frapper d’emblée d’insignifiance toutes les variations observées au manuscrit ainsi réputées d’avance capables d’affecter les accidents du texte mais non son essence, et donc s’exposer à adopter, tout en s’en défendant, cette perspective téléologique qui voit dans chaque correction du manuscrit une approche de son but. Et, de fait, la plupart des transcriptions génétiques partent, concrètement, du texte achevé et signalent, par rapport à lui, les écarts des différentes strates du manuscrit, comme si le texte définitif, déjà là, appelait vers lui les tâtonnements de l’écriture.
Cette édition veut procéder autrement et montrer Les Misérables comme une histoire, celle de la même œuvre mais qui se déploie en plusieurs textes –et elle comprend celui des Misères comme l’histoire de France inclut celle de la Gaule. Elle participe elle-même à cette histoire en établissant « le texte », c’est-à-dire, plus exactement, un état textuel de l’oeuvre, provisoire quoique le meilleur actuellement on l’espère ; elle la raconte aussi en incluant, dans les données d’établissement, les principales étapes de sa publication depuis le manuscrit jusqu’à l’édition de l’IN en passant par l’originale ; elle l’expose surtout en donnant à lire, comme des textes et non comme des « variantes » du texte, les états du manuscrit antérieurs à celui qui a servi à la publication. En droit, il n’aurait pas fallu s’arrêter là mais aller au-delà et en-deçà. En-deçà, c’est-à-dire englober les scénarios, notes, ébauches et rédactions abandonnées ; au-delà et joindre les adaptations, au moins la première, celle de Charles Hugo pour le théâtre, jouée et publiée, un an après l’originale, chez le même éditeur, sous le même titre et presque le même nom d’auteur, ainsi que les images des éditions illustrées que Hugo n’aurait pas autorisées s’il avait jugé qu’elles égaraient la lecture plus qu’elles ne la soutenaient. Des motifs de circonstance en ont dissuadé –la monstruosité de l’ensemble et aussi l’existence de l’excellent « Dossier des Misérables », publié par R. Journet ; de vraies raisons l’ont empêché et l’empêcheront sans doute longtemps : quelques concepts empiriques (ajout, retrait, développement, déplacement, infléchissement, censure, etc.) permettent de concevoir les glissements d’un état textuel d’une œuvre à un autre et leur analyse ne manque pas de modèles convaincants ; c’est déjà moins vrai s’agissant du saut d’un scénario à un texte rédigé ; l’étude des adaptations transgénériques, elle, commence à peine. Les philologues ont de la chance : le rhapsode en en cousant des fragments a fait disparaître les textes dont l’Iliade est issue et personne ne leur demandera jamais d’écrire son histoire de Homère à Brad Pitt.
Voilà pourquoi nous bricolons ici sans respect des règles actuellement admises pour les éditions génétiques ; d’autres considérations y conduisaient ; dressons d’abord l’état des lieux.
Etat des lieux : les manuscrits
L’histoire des Misérables, à s’en tenir au livre de Hugo, peut s’écrire à partir de trois séries d’informations.
D’une part la masse des écrits de toutes sortes –esquisses, idées, projets, listes de choses à faire, qui, sans former texte et sans appartenir à la rédaction proprement dite, l’accompagnent et la soutiennent. Hugo les avait rassemblés et ils se trouvaient à sa mort réunis dans trois chemises, partiellement sans doute et sans grand ordre puisque l’une contenait aussi des choses se rattachant à L’Homme qui rit. Sans se priver d’y ajouter d’autres papiers, les exécuteurs testamentaire et Cécile Daubray réunirent le tout dans un manuscrit relié, conservé maintenant à la BNF sous le titre « Les Misérables – Reliquat » (Nafr 24 744). A quoi il faut ajouter trois carnets (Nafr 13452, 18310 et 18878) employés de mai 1860 à septembre 1861 et contenant des ébauches pour le roman, des notes, de simples phrases isolées. Tout cela et d’autres fragments encore, extraits de l’océan des « fragments » a été réuni dans le « Dossier des Misérables » déjà signalé et publié par R. Journet au volume « Chantiers » de la collection des œuvres complètes de Hugo en Laffont-Bouquins.
D’autre part, et chevauchant partiellement cet ensemble car la rédaction se poursuit non seulement jusqu’à ce que la publication soit entreprise mais alors qu’elle est en cours et même un peu au-delà, la correspondance avec les éditeurs, prise en charge, on l’a vu, par B. Leuilliot.
Enfin le manuscrit proprement dit.
Il est continu et unique : conformément à son habitude, Hugo y porte en tête la date du début de la rédaction –17 novembre 1845– et inscrit celle de sa fin (sauf retouches) au dernier feuillet : « St Jean. 30 juin 1861. 8 h. ½ du matin. »
Il n’est pas entièrement autographe. Pour de brefs passages une copie, plus ou moins corrigée par Hugo, s’y substitue, de la main de Juliette ou de Julie Chenay, belle-sœur de l’auteur. Il arrive aussi qu’elle s’y ajoute et qu’on ait donc deux versions du même texte : en tête des feuillets contenant la rédaction initiale de tout le livre I, 1, Hugo note : « (Monseigneur Bienvenu.) (premier texte augmenté depuis. Placé ici comme annexe au manuscrit) » et, au début de II, 6 : « élagages à consulter au besoin », puis « les trois feuillets numérotés 1, 2, 3, contiennent la copie de l’ancien texte. – (je ne les conserve que pour collationner au besoin .) », enfin « variantes à consulter pour le livre V et le livre VI ». Il arrive même –c’est le cas pour tout le livre du couvent (II, 6) que le manuscrit prévoit explicitement un texte à publier différent du manuscrit («[…] ne faire les altérations de cette nature que sur la copie. »).
Ces exceptions donc, et quelques autres, mises à part, les strates successives de l’écriture se déposent sur le même manuscrit, sous forme de corrections, d’additions surtout et de rares suppressions. A la différence de Flaubert et de Balzac, Hugo n’écrit pas des versions successives in extenso et sur des supports différents. Ou du moins ne laisse-t-il pas de traces qu’il l’ait fait. Car outre les cas où c’est avéré par l’existence, dans le manuscrit ou le reliquat, d’un texte entièrement rédigé et abandonné, soit purement et simplement soit pour un autre, il est probable que parfois les mutations portées au manuscrit aient été d’abord préparées et essayées sur une feuille séparée que Hugo n’a pas conservée. Mais sûrement pas en règle générale : il y a trop d’exemples d’une addition déplacée d’une endroit à un autre par filets de renvoi pour qu’on puisse penser que ç’ait été fait par coquetterie et que la page avait préalablement été deux fois entièrement réécrite.
Que le même manuscrit porte tous les états textuels successifs de l’œuvre serait sans surprise et sans importance si l’exiguïté de leurs écarts ne laissait pas douter qu’il s’agisse du même texte, seulement travaillé et « amélioré ». Pour Les Misérables, c’est loin d’être le cas.
Les Misères / Les Misérables
V. Hugo commence la rédaction à l’un des moments les plus désastreux et les plus énigmatiques de sa vie, deux ans après la perte de Léopoldine, au lendemain de sa prise en « flagrant délit d’adultère » avec Léonie d’Aunet, épouse Biard, et dans la retraite obligée du récent scandale. « Je sais, écrit Sainte-Beuve, qu’il travaille enfermé à je ne sais quelle œuvre dont il espère que l’éclat recouvrira l’autre. » Vue courte et méchante mais sagace. Hugo est alors un écrivain arrivé : reconnu comme le plus grand du temps présent mais dont l’œuvre s’est raréfiée depuis quelques années et dont on n’attend plus grand chose, membre de l’Académie, bien sûr, et aussi de la haute assemblée d’alors, la chambre des pairs, familier sinon intime du Roi, de sa famille et généralement de tout ce qui compte, riche quoique sans aucun « bien », nanti de maîtresses, conservateur bon teint c’est-à-dire religieux, généreux, préoccupé de la « question social » et bien éloigné maintenant des jeunes énergies insurgées des années 1830 dont il avait été l’emblème et le porte-parole.
Comme à l’accoutumé pour les drames et les romans, Hugo écrit au fil du livre futur : de sa première page vers sa fin, avec des variations de rythme et des interruptions dont R. Journet et G. Robert (voir ci-dessous) donnent le détail – mais non sans retours en arrière au fur et à mesure, parfois mineurs et parfois décisifs, on le verra.
L’insurrection de février 1848, bientôt révolution, interrompt à la hauteur du premier paragraphe du chapitre IV, 15, 1 Buvard, bavard une rédaction assez avancée pour que l’auteur ait déjà préparé et laissé annoncer sa publication (voir B. Leuilliot, ouvr. cité, p. 18-20). Plus tard, Hugo inscrit en marge de ce paragraphe : « (Ceci a été écrit le 21 février 1848) » ; c’est peut-être trop beau pour être exact mais on n’a aucune raison de douter que ce soit vrai.
Pourquoi laisse-t-il passer douze ans et n’entreprend-il qu’en 1860 l’achèvement d’un livre dont la publication eût mis fin aux inquiétudes financières de l’exil? Peut-être même faut-il dire, pourquoi n’y parvient-il pas? puisqu’il est avéré qu’il s’y est essayé (voir B. Leuilliot, p.20-21 et R. Journet & G. Robert, p. 27). La réponse doit être lue dans ce qui sépare Les Misères des Misérables, et d’abord leur auteur de lui-même.
En 1860, l’exilé, déjà fort mal vu de la société française et européenne (interdiction en Belgique, asile fragile de l’Angleterre après l’expulsion de Jersey), vient de s’en exclure par son refus de l’amnistie générale et sans condition décrétée en août 1859 : « Quand la liberté rentrera, je rentrerai ». La formule, héroïque, manquait apparemment de bon sens. Elle lançait un pari gagé sur un échec immédiat puisque toute la gauche républicaine et socialiste acceptait sans grand risque l’occasion offerte par l’ « empire libéral »: réellement libéral, il s’affaiblirait, et ne s’affaiblirait pas moins à tenter de redevenir autoritaire. Hugo passait à l’extrémisme. En matière idéologique et religieuse, c’était déjà chose faite. L’histoire avait progressivement éloigné les vieilles Misères du livre attendu de l’exilé ; l’amnistie le mettait au pied du mur –là où l’on voit mieux le mur. Dans ce quitte ou double il ne restait, sauf à sombrer, au grand écrivain français un peu démodé devenu très grand écrivain français à travers Châtiments, Les Contemplations, La Légende des siècles, qu’à se révéler génie mondial. Hugo achève Les Misérables parce qu’il a refusé l’amnistie, à moins que ce ne soit l’inverse.
Quant au texte, un examen superficiel du manuscrit suffit à faire pressentir la distance qui sépare les Misères des Misérables. Beaucoup y manque : presque toutes les grandes « digressions » –Waterloo, la « parenthèse » sur le couvent et la prière, l’évocation du gamin de Paris pour sa plus grande part, le voisinage dans les substructions sociales des bandits avec les révolutionnaires, le portrait de Louis-Philippe, les analyses historiques de l’insurrection entre émeute et révolution–, mais aussi nombre d’épisodes et de personnages : l’évêque face au Conventionnel, Tholomyès et sa « bonne farce » faite à Fantine et ses amies, le pillage des cadavres par Thénardier à Waterloo et son sauvetage involontaire de Pontmercy, la rencontre avec Mme Thénardier et le portrait des aubergistes, la manière dont Jean Valjean sort du couvent dans un cercueil, les amis de l’ABC, la bande de Patron-Minette, l’attaque de Jean Valjean par Montparnasse… Une fois le manuscrit décanté, on voit que le livre a doublé de volume pendant l’exil. Le temps consacré par Hugo le suggérait d’ailleurs : presque le même pour écrire Les Misères que pour en faire Les Misérables. Sur ses 2, 5 millions de signes environ, 500 000 proviennent de l’achèvement du récit –la 5° partie, mais 800 000 des ajouts apportés dans les quatre premières parties, soit un accroissement de plus de 60%. Et si l’on se donne la peine de lire, ne fût-ce que des extraits, on éprouve une sorte de choc : c’est la même histoire mais pas le même livre. « Dans Les Misères, disent R. Journet et G. Robert, excessivement sévères peut-être, Hugo a jeté une esquisse générale, qui crée parfois l’impression de la rapidité stendhalienne, mais qui parfois aussi reste bien schématique. Il y a dans cette première rédaction beaucoup de phrases du type : « La marquise sortit à cinq heures », bien des conduits dont le seul intérêt est de relier entre eux des morceaux déjà plus fouillés. » Quant à la portée philosophique, politique et religieuse, elle est si profondément modifiée que Hugo, à deux reprises pendant l’exil, trouvant dans la condamnation le meilleur moyen du redressement, met en guillemets son texte et prête ce qu’il avait d’abord pris à son propre compte à des esprits vigoureusement stigmatisés : « politiques, ingénieux à mettre aux fictions profitables un masque de nécessité », « les habiles [ce qui] revient à dire les médiocres ».
On comprend que Gustave Simon, exécuteur testamentaire de la seconde génération, ait entrepris, avec l’aide de Cécile Daubray, de reconstituer le texte des Misères et de le publier (éditions Baudinière, 1927). Nous avons imité son exemple et ne sommes pas le premier ; Jean Pommier avait fait de même, toutes choses égales d’ailleurs, en publiant une autre Madame Bovary, formée d’états du manuscrit antérieurs à son achèvement.
Transcriptions
Une telle pratique est aujourd’hui abandonnée et stigmatisée ; on fournit des transcriptions censées, dans leur exactitude matérielle, s’affranchir de tout choix –subjectif– et permettre la saisie directe du travail de l’écriture. C’est traiter les manuscrits comme reliques saintes et ignorer ce que les historiens savent depuis toujours : que la reproduction des documents ne forme aucun savoir, que leur élaboration est indispensable à leur intelligence et qu’au-delà d’un certain seuil la quantité des informations produites fait obstacle à leur communication.
Les transcriptions diplomatiques, reproduction idéalement identique de la page avec simple substitution des caractères de l’imprimerie aux caractères manuscrits, se heurtent à des problèmes typographiques si ardus et, dans une page un peu chargée, si nombreux que, sauf exploits épuisants, elles ne remplissent jamais leur cahier de charge et le lecteur doit faire l’effort que s’épargne le transcripteur. L’ajout, ou la correction, interlinéaire se lit en clair au manuscrit parce qu’il est toujours légèrement plus proche de la ligne concernée ; la transcription le place au beau milieu de l’interligne et le lecteur ne sait plus à quoi il s’applique. Les additions marginales, le plus souvent écrites plus petit faute de place, une fois reproduites dans le même caractère que le texte principal, débordent leur localisation, se télescopent, deviennent irrepérables. Leur déplacement par rature des filets de renvoi est exclu, sauf dessin manuel. Comment représenter la variation minime de l'écriture qui signale un ajout sur la même ligne? Bref, tout à l’inverse de sa prétention, la transcription diplomatique présente une intelligibilité moindre que celle du manuscrit, à moins qu’il ne soit très court et très simple –c’est à dire dispensé de toute transcription. On y remédie par la juxtaposition, en double page du manuscrit et de sa transcription. Bel aveu. C’est demander au lecteur de refaire le travail que le transcripteur a fait (qu’il est censé avoir fait) mais dont le principe même de telles transcriptions l’empêche de communiquer les conclusions. Aucun savoir ne s’est ajouté, il s’en est perdu.
Les transcriptions codées subissent la même loi. Plus le code est simple –il peut être réduit aux trois opérations de substitution, suppression et ajout, mais mieux vaut alors reproduire les textes résultant de ces opérations–, plus il gagne en intelligibilité et en compréhension ce qu’il perd en quantité d’information (la distinction, par exemple, entre correction cursive et correction proprement dite), et inversement –au point d’aboutir parfois à des séquences de signes plus impénétrables que le manuscrit lui-même.
Surtout, codée ou diplomatique, la transcription dénie au
manuscrit sa nature même, celle d’un texte. L’écrivain, et aussi bien toute
personne qui écrit, n’inscrit pas des opérations d’écriture, des ratures, des
variantes inférieures ou supérieures, des ajouts en marge ou interlinéaires, il
produit un texte dont ces gestes ne sont que le moyen. Ils disparaissent instantanément
lorsque le clavier remplace la plume et l’écran le papier sans qu’aucun
écrivain s’en plaigne ; certains conservent les états successifs d’une
oeuvre, aucun ne veille à raturer ce qu’il supprime.
Qu’il faille rendre compte du résultat de ces gestes, certainement, mais de ces gestes eux-mêmes pourquoi le ferait-on lorsqu’ils n’ont pas de pertinence ? De celle-ci, le généticien est juge, juge légitime –qui le serait sinon lui ?– et il lui appartient de mettre en œuvre son savoir au lieu d’en faire abstraction et de se réfugier dans la description, ou la reproduction, de la matérialité du manuscrit comme s’il était écrit dans une langue étrangère ou ne présentait aucun sens.
Disons-le, les transcriptions rendent au manuscrit un culte médiéval, sorte de messe noire. Pour mieux honorer le vrai Dieu, l’œuvre ? Peut-être. Pour éloigner les néophytes, possibles concurrents futurs, peut-être aussi. Quoi qu’il en soit, elles intimident.
Tout ceci, Jean Gaudon, dans son article "Les illusions de l'exhaustuvuté" (Hugo de l'écrit au livre, B. Didier et J. Neefs dir., PUV, 1987) l'avait fort bien dit et prouvé sur un exemple précis. En vain apparemment.
Journet et Robert
On n’incriminerait pas de la sorte sans injustice René Journet et Guy Robert, Journet surtout. Leurs travaux sur les manuscrits de Hugo ont été décisifs, exemplaires, et c’est peu de dire que celui-ci n’aurait pas été possible sans eux puisque dans une très large mesure (75…80%, plus peut-être) il ne fait rien de plus –ni de moins- que de donner une autre forme aux acquis de leur ouvrage, Le Manuscrit des Misérables (Annales littéraires de l’Université de Besançon – Les Belles Lettres, 1963).
C’est, après une brève mais très dense introduction trop modestement intitulée « Chronologie sommaire », une description du manuscrit. Soit, pour 83 chapitres, sa transcription codée exhaustive et, pour le reste, un « tableau sommaire » des principaux ajouts et suppressions, les corrections étant laissées de côté. Leur science est impeccable, leur capacité de déchiffrement de l’écriture, parfois difficile, de Hugo inégalée, l’exactitude de leurs transcriptions déconcertante. Leur travail permettait et appelait le nôtre : tout à la fois refaire celui de Gustave Simon en évitant ses errements et donner une forme accessible au leur. Car l’extrême précision du code adopté aboutit d’une part sinon à l’inachèvement de l’entreprise du moins à son caractère partiel et inégal, d’autre part à son opacité.
On ne prend aucun risque en défiant quiconque de reconstituer, sans avoir le manuscrit sous les yeux, la rédaction initiale du paragraphe en cause dans cette description (p. 53-54) :
« 179-193 1re rédaction rayée de ce passage (sur la partie droite du f° 190 r°) :
|Jean Tréjean| s Il | fit | ainsi | s de la sorte | un assez long chemin, | asp regardant, appelant, [autre asp] criant |mais il ne passait personne. | amp Deux ou trois fois il courut dans la plaine vers quelque chose qui lui faisait l’effet d’un être couché et accroupi ; mais ce n’était que / as des broussailles ou / des / broussailles / sc roches / à fleur de terre. | Enfin, à un endroit où trois sentiers se croisaient il s’arrêta. | Il |am La lune s’était levée. Il | regarda au loin et appela une dernière fois : Petit-Gervais ! Petit-Gervais ! Petit-Gervais ! | Sa voix | sc Son cri | s’éteignit dans les ténèbres sans même éveiller un écho. | Alors | as En ce moment | ai / Il cria encore / sc Il murmura encore / : Petit-Gervais, mais d’une voix faible et presque inarticulée, puis | il sentit ses jarrets fléchir sous lui comme si une puissance invisible l’accablait | tout à coup | sp enfin | du poids de sa mauvaise conscience. Il tomba épuisé sur une grosse pierre les poings dans [ici se termine cette 1re rédaction rayée, qui se poursuivait par « ses cheveux » (193) en haut du f° 190 v°] f° 190 v°]
La rédaction définitive se trouve en marge gauche du f° 190 v°. »
Ou bien encore, on comparera notre édition des états successifs du début de III, 6, 9 Eclipse (http://groupugo.div.jussieu.fr/Miserables/Consultation/Tableau/Tableau_030609.htm) avec ceci (p. 336):
« F°s 825 et 828. Papier B1 pour les trois premiers §, mais le 1er seul est entièrement nouveau (1860). Le 2me ne fait que reproduire (sauf la var. 851 b) un texte déjà écrit en 1847 sur papier A1 (f° 825) (1). Quant au 3me § il développe la phrase qui dans la rédaction de 1847 terminait le paragraphe précédent (après « où elle demeurait ».) : Il fit un jour une | sp troisième| faute. Immense. Il la suivit.
Après ces trois premiers §, retour au papier A1.
(1) Voir ci-dessus chap. VII, Sup. ex (1860). »
Innovation
La lisibilité que nous avons recherchée n’est pas neutre, pas plus que le parti pris de l’illisible. Outre ses implications doctrinales énoncées, elle repose sur l’analyse de ses conditions particulières. Lorsque, en effet, l’écrivain porte une série de modifications sur une feuille et en prend une autre pour les enregistrer –puis en ajouter d’autres et ainsi de suite, comme fait Flaubert–, l’existence de manuscrits distincts autorise qu’on traite comme un texte l’aboutissement des opérations d’écriture effectuées sur chaque feuille, même s’il n’est pas exclu que le recopiage sur une nouvelle feuille du résultat du travail effectué sur la précédente n’ait été dû qu’à l’encombrement du papier. Mais, dans le cas de Misérables, le même manuscrit, sauf exception, porte toutes les corrections, des premières aux dernières, ce qui accrédite l’idée d’une continuité du travail telle qu’on ne saurait sans arbitraire y découper des étapes et des « versions » de l’œuvre. C’est apparemment la conviction de J. Journet et G. Robert qui la portent si loin qu’ils ne voient aucune nécessité interne au terme mis à cette gestation : « …l’œuvre s’est accrue par un gonflement intérieur, qui n’a été arrêté que par les nécessités de l’édition. » Si bien que l’état du texte lorsque Hugo en abandonne la rédaction en 1848 ne leur semble pas provisoire seulement parce qu’il y manque la fin du récit, mais parce que ses parties entièrement rédigées elles-mêmes doivent être tenues pour seulement ébauchées : « Dans Les Misères […] Hugo a jeté une esquisse générale […]. Croire que cette relative sécheresse est la manière de Hugo à l’époque, ce serait confondre l’esquisse et le tableau. »
Mais pourquoi, s’il en est ainsi, donner titre d’œuvre –Les Misères– à l’esquisse ? employer constamment le mot de « version » et distinguer avec un tel soin dans le continuum des ajouts et corrections ce qui date d’avant l’exil de ce qui date de l’exil ? Leur position est discutable.
Il l’adoptent sans doute, pour une part, par alignement de la théorie sur leur pratique plus que l’inverse et aussi par réaction contre la publication de G. Simon, constamment critiquée dans le détail –à juste titre le plus souvent, mais pas toujours– et récusée de la sorte dans son principe même. Elle se heurte surtout à la publication prévue dans un délai rapproché dès avant le début de l’année 1848, et que le soin mis aux corrections de cohérence, de vraisemblance et de style montre parfaitement raisonnable. Impossible de mesurer l’inachèvement des Misères en les rapportant aux « intentions » de l’auteur, qui sont hors de portée ; du moins peut-on s’assurer au texte ici fourni qu’il n’a plus rien d’une « esquisse ».
Curieusement d’ailleurs, dans le détail des choses, R. Journet et G. Robert déportent vers la période d’avant l’exil le plus d’ajouts et corrections qu’ils peuvent et, en cela, s’exposent parfois, on le verra, au démenti. On s’attend au contraire de la part de qui veut montrer une « esquisse » dans Les Misères. Est-ce inconséquence ? En apparence seulement. Car l’unité de l’œuvre à travers la coupure de l’exil et l’impossibilité d’y découper deux textes substantiellement différents, apparaît plus grande si la part faite à l’écriture de l’exil se réduit aux redressements idéologiques et surtout politiques. Pour Journet et Robert, Les Misérables sont déjà tout entiers dans Les Misères à la politique près. Nous n’en croyons rien.
Si les circonstances avaient donné à Hugo le temps d’achever Les Misères, il aurait publié tout autre chose que Les Misérables, et plus probablement rien du tout parce que leurs contradictions menaient à une impasse. La correction politique –une appréciation plus favorable des insurgés– ne suffisait pas à donner valeur de sacrifice à leur mort, moins encore à celle de Gavroche, Eponine et Mabeuf. Il y fallait une perspective historique, entièrement absente des Misères, et qui, du Conventionnel à Quel horizon on voit du haut de la barricade en passant par Waterloo, le couvent, le gamin, l’argot, etc., donne cohérence à l’essentiel des modifications apportée en 1860-62. La substitution, au début de la quatrième partie et au début de son livre 10, d’une discussion historique à la discussion politique antérieure est un des signes les plus flagrants de ce changement de point de vue, auquel La Légende des siècles n’a sans doute pas été inutile. Il y fallait aussi l’expérience intime du sacrifice : l’exil, simple combat jusqu’alors, n’en devient un qu’avec le refus de l’amnistie.
Il faut reconnaître cependant une continuité forte, pour d’autres aspects, entre les deux campagnes d’écriture. Réaliste en même temps que philosophique, le texte tendait à le devenir dès avant 48 ; le nombre des personnages augmentait déjà, la finesse de leur caractérisation aussi ; des épisodes nouveaux –la charrette Fauchelevent pas exemple– avaient commencé de s’ajouter.
C’est la raison pour laquelle on met ici entre guillemets « Les Misères », titre hypothétique d’un texte virtuel, et qu’on souligne, aussi fortement que possible, que la publication qui en est faite ne vaut pas comme édition d’une « version » de l’œuvre mais comme transcription de l’un de ses états textuels, provisoire mais déjà consistant.
C’est aussi la raison pour laquelle on l’a doublé de la transcription d’un autre de ses états textuels, le premier. Sa comparaison avec le second permet de mesurer le chemin parcouru dès avant l’exil et aussi de caractériser non pas sans doute l’inspiration originelle de l’œuvre mais du moins son orientation initiale.
Datation
Le texte des « Misères » est donc construit par datation des éléments du manuscrit. Fort heureusement la difficulté de la prononcer croit à mesure que son intérêt diminue.
Certaine pour les grandes unités, chapitre ou livre, où tous les critères convergent et où peut intervenir celui du papier employé –R. Journet et G. Robert en ont répertorié les sortes et les dates d’usage–, la discrimination entre passages antérieurs et postérieurs à l’exil l’est déjà moins à l’échelle du paragraphe. Mais l’emploi des noms de personnages et la critique interne confortent ici, le plus souvent, l’appréciation tirée de l’écriture et de la disposition. En revanche, l’incertitude est grande lorsqu’on descend au niveau de la phrase ou du mot ajouté dans la marge et, plus souvent, en interligne. Ici, il faut se fier à l’écriture. Or Hugo, avant comme après l’exil, en a plusieurs à sa disposition, dont deux seulement sont nettement reconnaissables et les trois ou quatre autres singulièrement ressemblantes de part et d’autre de l’exil.
R. Journet et G. Robert ne le cachent pas mais assurent la distinction possible et, de fait, avouent très peu d’incertitudes. Leur expérience vaut expertise. Mais celle de Cécile Daubray n’est pas moins avérée et s’il est vrai que l’ouvrage de G. Simon, auquel elle a sans doute beaucoup contribué, tend souvent à donner pour texte des Misères ce qui, en réalité, appartient à la rédaction initiale et est corrigé dès avant 1848, beaucoup de cas restent incertains et demandent qu’on tranche. On l’a fait ici, en règle générale, dans le sens de Journet & Robert. Parfois sans conviction. Car on rencontre, dans les manuscrits de Hugo à la BN, trop de fragments, portant de la main de C. Daubray, au crayon et carrément sur la feuille même, une date éloignée de plusieurs années ou dizaines d’années de celle que leur donnent Journet & Robert, pour partager leurs égales certitudes.
On n’a pas hésité en revanche devant les cas d’erreur avérée, dont le nombre, trop grand pour qu’on les cite tous, inquiète moins que l’orientation constante vers l’anti-datation, aussi constante que celle de C. Daubray en sens inverse :
- A la fin de II, 3, 6, Journet & Robert datent d’avant l’exil le dernier paragraphe : « En cheminant par le taillis dans la direction de Montfermeil, il avait aperçu… » ; mais ils datent de l’exil l’ajout : « Vis-à-vis de cet arbre qui était un frêne, il y avait un châtaignier malade d’une décortication.. » Or le début du dernier paragraphe est écrit au-dessus d’une première rédaction : « Un peu après avoir dépassé le châtaignier, il avait aperçu… ». Comme il n’y a pas d’autre mention de l’essence de cet arbre que celles en ajout de l’exil, il faut bien que la rédaction du dernier paragraphe soit également de l’exil. A moins que Hugo ait toujours identifié cet arbre comme un châtaignier, mais oublié de le noter ici. Ce n’est pas impensable mais ne peut être retenu sans que le même raisonnement ruine toutes les datations tirées de la comparaison interne des textes.
- En II, 4, 3 l’addition « En prenant les mots dans leur sens… le père de Cosette. » est notée « addition postérieure » et non « addition de l’exil » alors que le nom du héros y est « Vlajean » corrigé en « Valjean » et que Journet & Robert datent eux-mêmes de 1860 l’apparition de « Vlajean » en remplacement de « Tréjean ».
- A plusieurs reprises, et bien avant la fin de la 4° partie où le nom de Marius, définitivement adopté, selon une note du Journal de ce que j’apprends chaque jour, le 9 février 1848, entre en concurrence avec celui de Thomas, ils datent d’avant l’exil des passages où « Marius » est inscrit d’emblée et sans surcharger « Thomas » : III, 6, 4 pour l’addition « Il y avait près du bassin un bourgeois… Marius écouta le bourgeois. » ; III, 8, 3 pour l’addition « S’évertuer à deviner…qui se moquaient de lui. » ; III, 8, 21 : « On se souvient qu’il avait le passe-partout de Marius. »
- Dans le même ordre d’idée, en IV, 12, 1, la correction « Deux servantes appelées Matelote et Gibelotte, et auxquelles on n’a jamais connu d’autres noms aidaient Madame Hucheloup » n’aurait pas dû être classée parmi celles d’avant l’exil puisque Journet & Robert, dans leur précieuse liste des modifications des noms des personnages, datent de l’exil l’apparition de ceux-ci.
- Plus grave parce qu’il s’agit d’un détail mémorable, ils donnent comme addition d’avant l’exil tout le texte évoquant, en IV, 3, 1, le soin avec lequel Jean Valjean emporte « la petite valise dont il avait toujours la clef sur lui » et ne consentent à dater de l’exil que la dernière phrase : « Cosette en riait et appelait cette valise l’inséparable, disant : J’en suis jalouse ». C’est oublier qu’ils ont eux même daté de l’exil, et plus précisément d’après mars 1861, toute l’addition, en II, 8, 9 : « Cosette en devant pensionnaire du couvent, dut prendre l’habit des élèves…. –Père, lui demanda un jour Cosette, qu’est-ce que c’est donc que cette boîte-là qui sent si bon ? », développement et explication auxquels renvoie ce passage de IV, 3, 1 et sans lesquels il n’a pas de sens.
- Il arrive enfin qu’une information extérieure au manuscrit démente une datation. L’addition marginale qui, en IV, 3, 6, note l’incorrection du port d’une robe de damas par une jeune fille et en excuse Cosette sur le défaut des conseils d’une mère répond trop exactement pour ne pas être de l’exil à cette ligne de la liste de consignes que Hugo se fixe à lui-même dans le carnet d’avril-mai 1860 (Chantiers, p. 735) : « Ne pas donner à Cosette une robe de damas. » Si Hugo avait justifié dès avant l’exil cet accroc au code vestimentaire, il n’aurait eu aucune raison d’en prévoir la correction en 1860.
Texte initial
La transcription du texte initial est plus aisée. On procède par élimination et les critères sont évidents et simples : l’ajout, dans l’interligne ou en marge, se voit ; la correction également, par surcharge ou par rature et remplacement ; la suppression pure et simple aussi. Les additions par intercalation de feuilles entières seraient parfois difficilement repérables si la numérotation des feuilles par Hugo (chacune, pliée en deux et écrite recto-verso, contient quatre pages) ne la décelait, soit qu’il surcharge la numérotation antérieure, soit qu’il affecte l’intercalation d’un indice ( bis, ter, etc.) lorsqu’il faudrait corriger trop de feuilles. Reconnaissons cependant que cette méthode, assez sûre le plus souvent, ne suffit pas à lever quelques incertitudes : une demi-feuille (deux pages au lieu de quatre) a pu être employée et bouleverser la pagination ; une feuille nouvelle a pu être substituée à la première. Ces difficultés sont signalées.
Et l’on s’en tiendrait là s’il ne fallait répéter que notre « texte initial » ne correspond nullement à une « première version » de l’œuvre, ni non plus à un premier état, ni même à aucun état du texte à un moment « T ». Hugo en effet procède de manière tabulaire en même temps que linéaire : par retour en arrière pour corrections et ajouts en même temps qu’il continue d’avancer. Il n’attend pas d’avoir achevé une séquence du récit pour y revenir et ne s’interdit pas non plus de le faire longtemps après l’avoir dépassée. Il peut fort bien, par exemple, intercaler un chapitre en première partie alors qu’il est en train de rédiger la seconde ; on le voit également effectuer des additions ou des corrections dans un chapitre dont la rédaction est en cours –et il est même assez vraisemblable qu’une journée de travail commence par la révision de la précédente, ou comporte cette tâche à un moment quelconque. A la différence donc des « Misères » qui donnent l’état du manuscrit lorsque Hugo cesse d’y travailler, au début de 1848, notre « texte initial », composé de moments différents, n’enregistre rien que Hugo ait jamais eu sous les yeux. Il faudrait employer le pluriel pour le désigner : « états initiaux du texte » ou « état initial des textes ».
Cela explique ce qui passerait pour des incohérences si Hugo avait écrit d’un seul jet toute une première version, avant de la revoir et, par exemple, le changement du nom d’un personnage au cours d’une même séquence.
En toute rigueur, cet « état initial » ne devrait donc servir qu’à prendre la mesure du travail accompli. Il s’offre cependant à une lecture suivie, à peine entravée par les ruptures de continuité qu’on a dites, parce que, quelques cas exceptés (le portrait de Javert, et l’entrée en scène de Gavroche en particulier), la structure d’ensemble du récit est assez stable pour que ces textes initiaux ne s’éloignent pas beaucoup d’une « première version ». A la différence de ce qui se produit en 1860-62, les ajouts et intercalations d’avant l’exil changent la physionomie du texte, mais modifient peu le cours de la narration (nature et proportions des épisodes, composition et caractérisation du personnel romanesque, qualité de la voix narrative, équilibre entre récit, description et dialogues). Le fameux fragment de quatre lignes mis à part –« Histoire d’un saint / Histoire d’un homme / Histoire d’une femme / Histoire d’une poupée. » –, on ne connaît aucun plan, aucun scénario pour les Misérables ; mais tout se passe comme si la rédaction en avait suivi un, sans que les additions, importantes pourtant en volume (+ 40%), n’en affectent l’exécution.
En revanche, l’écart littéraire entre le texte initial et son état en 1848, très mince dans les grandes scènes, est ailleurs si grand que le texte initial semble fonctionner à la manière d’un scénario, immédiatement développé dans les seuls moments forts. Le nom d’esquisse lui convient bien mieux qu’aux Misères. Mais moins à mesure que la rédaction avance –et l’écart entre eux va diminuant de la première partie à la quatrième. Cela se conçoit. Non pas que Hugo prenne de l’assurance ni qu’il sache mieux où il va, mais l’acquis, en s’épaississant, programme toujours l’actuel de manière de plus en plus contraignante ; l’éventail des possibles narratifs se restreint, celui des choix d’écriture également. Et cela d’autant plus que, précisément, Hugo revient en arrière en même temps qu’il poursuit. Fixer un état presque définitif de ce qui précède sans attendre d’être arrivé au bout lui permet d’écrire un premier jet progressivement plus proche de l’état définitif.
Cette récursivité donne consistance forte à l’œuvre. Elle harmonise ses modalités d’écriture et assujettit ses parties les unes aux autres. Et elle explique, en partie mais sans doute en très grande partie, le retard mis à l’achèvement du livre une fois la rédaction interrompue. Provisa res, dit Hugo avec confiance en 1860, au moment de reprendre la rédaction là où elle avait été interrompue. C’est qu’il sait alors comment il réorientera son œuvre ; mais il lui a fallu plusieurs mois pour le concevoir et ce devait être assez ardu pour que la décision de l’entreprendre ait, elle, été ajournée pendant plus de dix ans. La res était provisa mais dans un tout autre sens et sa métamorphose n’en était que plus problématique.
Mise en forme
Pour le texte initial comme pour « Les Misères », lorsque le manuscrit reconnaît valeur égale à deux versions –superposées ou juxtaposées sans qu’aucune soit biffée– elles sont présentées toutes deux, la seconde désignée comme « variante sans choix » de l’autre.
Dans les deux textes également, la reproduction de la graphie de Hugo aurait violemment contredit les habitudes de lecture, alors même que nous voulons garder à ces textes la lisibilité qu’ils avaient pour leur auteur (et ses copistes), loin du déchiffrages des transcriptions. On reproduit donc les majuscules adoptées pour l’édition du texte définitif. Ce sont des détails.
N’en est pas un en revanche le fait que le principe adopté d’enregistrer non les opérations d’écriture mais leur résultat, aboutit à passer sous silence les transformations qui n’ont pas été retenues, soit dans le passage du texte initial aux « Misères », soit dans celui allant des « Misères » aux Misérables. Manque surtout le détail de la genèse des textes sans équivalent dans l’état antérieur : additions au texte initial dans « Les Misères » et tout ce qui, à partir du chapitre IV, 14, 1, Buvard, bavard, est rédigé pendant l’exil. C’était le prix à payer. En « génétique littéraire », l’exhaustivité est toujours inversement proportionnelle à l’intelligibilité –et souvent à l’utilité ; dès qu’on transcrit, de quelque manière que ce soit, on perd de l’information et il est de la responsabilité du « savant » de fixer l’équilibre entre ce que le manuscrit lui montre et ce qu’il peut en communiquer. Prétendre tout dire, en cette matière, c’est tout garder pour soi.
Le texte des « Misères », on l’a dit, n’est pas donné pour la transcription d’un manuscrit : la datation de ses éléments est trop incertaine. En conséquence, on s’est affranchi des contraintes habituelles d’une transcription : références des folios, notation des mots illisibles ou barrés, respect de l’orthographe. Les suppressions, elles, font problème : impossible de savoir de quand date le trait de rature lorsqu’il s’agit bien d’une élimination pure et simple et non d’une correction. On a pris le parti de les dater systématiquement d’avant l’exil, parti conforme au principe d’économie des hypothèses puisqu’à faire le choix inverse, il faudrait expliquer pourquoi Hugo a attendu l’exil pour supprimer ce qu’il pouvait abandonner tout de suite.
Le texte initial, non pas reconstruit mais observé et établi, est lui justiciable d’une transcription proprement dite, sans aucun code puisqu’on retient ce qui est antérieur à toute modification, mais respectueuse de l’orthographe –à l’exception des accents qui manquent souvent–, assortie des références aux manuscrits et de commentaires lorsqu’ils sont nécessaires. Les parties biffées sont, par définition, lues (dans la mesure du possible) et intégrées au texte, la rature étant nécessairement postérieure à l’écriture. Les mots que nous ne sommes pas parvenus à lire à ce titre sont signalés d’une croix.
Cependant il arrive souvent, plus souvent qu’on ne croit et cela dément l’idée que le manuscrit n’est qu’une mise au net, qu’une rature soit effectuée en correction cursive –lorsqu’il y a encore de la place à droite- et enregistre ce que R. Journet et G. Robert appellent un « faux départ ». On n’a pas cru nécessaire, dans ce cas, d’informer le lecteur de cette hésitation. Par exemple, en I, 7, 3, f° 320 v°, Hugo commence par écrire : « La seule pensée que c’était possible le faisait friss » ; il n’achève pas le mot et barre « La seule » ainsi que « le faisaient friss » et ajoute en marge, devant « pensée », « Il frémissait de la seule ». Ici, on se contente de donner le texte résultant de la correction : « Il frémissait de la seule pensée que c’était possible. » C’est bien celui de la première rédaction, puisque ce qui avait été écrit antérieurement a été abandonné avant même que la rédaction de la phrase soit achevée. Mais il arrive que la rature elle-même rendant le texte entièrement illisible, empêche de décider s’il s’agit d’une véritable suppression ou d’une correction cursive ; on signale ce genre de lacune par autant, ou à peu près, de croix que de mots, le tout entre crochets et en italiques.
Enfin, pour le texte initial comme pour « Les Misères », lorsqu’une correction, par surcharge ou rature, a rendu illisible le texte abandonné, nous comblons la lacune par la correction, alors placée entre deux °.
Présentation
Les textes donnés sous le mode « lecture » sont faits pour elle : dépouillés des références et de tout commentaire, sinon ceux indispensables, dans le « texte initial », pour que ses incohérences apparentes ne soient pas mises au compte de notre distraction ou d’une négligence de la part de Hugo. Ils offrent cette supériorité sur toute autre forme d’édition qu’on a pu y effacer le découpage en parties et livres, ainsi que leurs titres, qui sont de l’exil, et reproduire les blancs du manuscrit. Ils correspondent à coup sûr non seulement à un fait d’écriture, mais aussi à un rythme souhaité de la lecture auquel Hugo a finalement renoncé devant l’amplification considérable du livre dans toutes ses parties pour lui substituer les articulations que nous connaissons.
Le mode « consultation » appelle les textes par livres et chapitres ; c’est une commodité indue en son principe pour le texte initial et celui des « Misères ». Les références au manuscrit y figurent pour le texte initial ; dans quelques cas signalés on y donne aussi, dans leur premier état, des intercalations sans doute très proches du « premier jet » puisque la rédaction initiale de la suite du récit intègre leur présence. Les commentaires, placés entre crochets, en italiques et en police inférieure, ont été réduits au nécessaire : nous ne nous sommes pas crus tenus de justifier toutes nos décisions ; leurs raisons apparaîtront d’elles-mêmes à ceux qui se reporteront au manuscrit ; auprès des autres, elles seraient oiseuses, fatigantes, et vainement rébarbatives.
Dans les tableaux juxtaposant les trois textes en vue de leur comparaison, nous avons voulu faciliter cette dernière par un jeu de couleurs. En noir, tout texte nouveau par rapport à l’état antérieur –et le texte initial l’est donc tout entier. En gris, ce qui dans le second et le troisième état est repris du précédent. En vert ce qui, dans un état du texte, ne figure pas dans l’état ultérieur et n’y est pas non plus modifié –vert clair pour une suppression affectant un texte repris de l’état antérieur et vert foncé pour la suppression d’une modification ou d’un ajout.
Ces indications, destinées, répétons-le, à faciliter la comparaison des textes, ne valent nullement comme code de transcription. Elles rejoignent parfois la réalité matérielle du manuscrit –les textes raturés seront en vert– mais n’ont pas vocation d’en informer : le gris correspond bien, dans la colonne des « Misères », à un texte écrit dans la partie droite de la page puisque Hugo l’occupe d’abord et réserve la marge aux additions ; mais, dans la colonne de droite des Misérables, il peut désigner aussi bien une addition marginale ou interlinéaire que le texte principal d’une intercalation effectuée avant l’exil. Ces couleurs ne correspondent pas non plus à une opération d’écriture : le noir, en colonne centrale ou de droite, vaut pour toute modification, aussi bien une addition qu’une substitution. Au reste, les trois opérations que les généticiens distinguent ordinairement –suppression, ajout et substitution– ne se discernent pas toujours si aisément qu’il semble et cela se produit plus souvent qu’on croit. Entre « Thénardier se pencha vers lui » et « Thénardier se pencha au bord du mur » y a-t-il substitution de « au bord du mur » à « vers lui » ou bien suppression de « vers lui » et ajout de « au bord du mur » ? Un « Thénardier se pencha vers lui au bord du mur » n’avait rien d’impossible. Or, ajoutons-le, l’examen du manuscrit ne lève nullement l’incertitude : une surcharge vaut élimination du texte surchargé et c’est sa valeur pour le sens qui décide si elle le corrige ou y supprime et ajoute.
Pour ne pas barioler la page, on en est resté là. Non sans inconvénient : pour indiquer une modification de l’ordre des mots, on s’est contenté de porter en noir les premières lettres du mot ou du membre de phrase concerné et ce n’est pas toujours bien clair ni du plus heureux effet.
Enfin, on s'est efforcé d'être précis. Non sans l'inconvénient de privilégier ainsi les transformations de style. Telle page -tout le livre 4 de la première partie- semblera neuve alors qu'elle ne fait que développer des éléments déjà présents dans la version précédente; la signification de telle autre inversement (le récit de la mort d'Eponine en IV, 14, 6) est bouleversée par un ajoût de deux lignes qui risque fort de passer inaperçu. En un mot la comparaison des textes n'éclaire leur compréhension que sous condition de la réciproque.
Illustration
Voici une photographie du f° 856 v° : fin du chapitre III, 8, 6 L’homme fauve au gîte et début du suivant Stratégie et tactique (la coupe est marquée seulement par un tout petit « VII », neuf lignes avant la fin). Le lecteur, si son navigateur le permet, agrandira ou réduira l’image pour lui donner les dimensions du papier employé (20,8 x 27) et constater que l’écriture de Hugo est petite. Du moins voit-on aisément: l'importance des corrections et additions, la pratique des ajouts imbriqués ou complétés par un second ajout, la difficulté qu'il y a à distinguer les écritures (on a employé ici la description par Journet & Robert, p. 342-343), la surcharge régulière de "Thomas" par "Marius", et la préparation, dont notre édition ne peut pas rendre compte, de l'addition (en haut tout à fait à gauche) par: "Les enfants avaient dû renoncer au pain avant que le père renonçât au tabac." marquée d'un point d'interrogation indiquant l'hésitation de Hugo avant sa décision. On mentirait en prétendant qu’on a choisi ce folio parmi les plus limpides.